 |
 |
|
 |
 |
| NUMERO 856 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
Edition du 15 Juillet 2016
|
|
|
|
 |
Edito
Vers une nouvelle approche conceptuelle de la maladie d’Alzheimer

Cette semaine, l’actualité scientifique récente nous conduit à revenir une nouvelle fois sur un sujet grave, la maladie d’Alzheimer. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y aurait au moins 35,6 millions de personnes dans le monde atteintes par cette pathologie neurodégénérative qui représenterait 60 à 70 % du total des démences répertoriées. Et sous l’effet du vieillissement massif de la population mondiale, ce nombre de malades d’Alzheimer pourrait atteindre 66 millions en 2030.
En France, la maladie d’Alzheimer touche environ 900 000 personnes et constitue à présent la 4e cause de mortalité. 225 000 nouveaux malades sont diagnostiqués chaque année, avec une survie moyenne de 8 ans et demi après l'annonce du diagnostic.
Il faut toutefois rappeler qu’une une étude (que nous avons déjà évoquée dans notre lettre) publiée début 2016 et réalisée par les chercheurs de l'Ecole de santé publique de Bordeaux et ceux de l'Université de Boston, suggère que le taux réel (c’est-à-dire ramené au vieillissement et à l’augmentation de la population) d'apparition de nouveaux cas de démence serait en diminution. En examinant quatre périodes distinctes situées entre 1970 et 2009, les chercheurs ont découvert un déclin progressif de l'incidence de la démence à tout âge, avec une réduction moyenne de 20 % tous les dix ans, sans doute grâce à une meilleure prise en charge de pathologies associées, comme le diabète, l’hypertension ou l’hypercholestérolémie. Mais la prévalence de cette terrible maladie, qui intègre à la fois les nouveaux cas et les malades plus anciens, va tout de même continuer à augmenter compte tenu du vieillissement inexorable de notre population.
Depuis quelques semaines, plusieurs découvertes et avancées importantes sont venues éclairer d’une lumière nouvelle cette redoutable maladie et relancer l’espoir de nouvelles pistes thérapeutiques. Tout d’abord, des chercheurs de l'Université d'Aberdeen, dirigés par Bettina Platt, ont montré que les complications cérébrales liées à la démence peuvent également entraîner des perturbations dans la gestion du glucose par l’organisme et provoquer, in fine, un diabète. Il est donc possible que le diabète puisse commencer par ce dysfonctionnement cérébral plutôt que par un dysfonctionnement du pancréas. (Voir Springer).
En développant un modèle animal de la maladie d'Alzheimer, ces chercheurs ont découvert que des niveaux accrus d'un gène impliqué dans la production de protéines toxiques dans le cerveau (type amyloïde), non seulement entraîne des symptômes semblables à ceux rencontrés dans la maladie d'Alzheimer, mais aussi dans les troubles métaboliques. Il semble notamment que le gène BACE 1, dont on sait à présent qu’il joue un rôle majeur dans la régulation du glucose, joue un rôle clé dans l’apparition de la maladie d'Alzheimer en favorisant la multiplication de la protéine précurseur de l'amyloïde. « Il est indéniable et troublant que 80 % des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer présentent également une forme de diabète ou des perturbations du métabolisme du glucose », rappelle Bettina Platt.
Si cette hypothèse scientifique se confirme, cela voudrait dire que les facteurs liés au mode de vie, notamment les facteurs alimentaires responsables du diabète, pourraient jouer un rôle important dans l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Ces recherches montrent, en tout cas chez l’animal, que les médicaments actuellement utilisés pour contrôler les niveaux de glucose dans le diabète peuvent aussi soulager les symptômes et la progression de la maladie d'Alzheimer. Commentant ces travaux, le professeur Platt précise que « la bonne nouvelle est qu'un certain nombre de nouveaux médicaments sont désormais disponibles et nous allons les expérimenter sur l’animal, puis chez l’homme, pour voir s’ils peuvent à la fois améliorer les symptômes d'Alzheimer et ceux du diabète. »
Une autre voie de recherche semble pleine de promesses : il s’agit d’un nouveau vaccin anti-tau développé et actuellement expérimenté sur l’homme par la société de biotechnologie Axon Neuroscience (basée à Bratislava, en Slovaquie), dans le cadre de l’étude ADAMANT de phase II (Voir LABIOTECH).
Le vaccin AADvac1 d’AXON est prévu pour être le premier vaccin anti-tau modificateur de la maladie d’Alzheimer. Ce vaccin dit « thérapeutique » est conçu pour produire les anticorps contre la protéine tau pathologique, qui est la cause principale de la pathologie neurofibrillaire dans la maladie d’Alzheimer. Ces anticorps devraient empêcher la protéine tau d’avoir des interactions pathologiques, pour faciliter la suppression de la pathologie tau et ainsi ralentir ou stopper la progression de la maladie d’Alzheimer.
Ces essais cliniques sur l’homme s’inscrivent dans le cadre d’ADAMANT, une vaste étude prévue pour durer deux ans et destinée à mesurer l’efficacité thérapeutique de cette approche sur des malades souffrant d’un Alzheimer d’intensité légère. L’étude ADAMANT sera menée dans plusieurs pays d’Europe, où 185 patients devraient être recrutés pour y participer.
Autre piste qui semble confirmer ses promesses : celle des effets positifs du resvératrol -un antioxydant présent dans les raisins, le vin ou le chocolat- sur l'hippocampe, une zone du cerveau essentielle pour la mémoire, l'apprentissage et l'humeur.
Le resvératrol est une substance phytochimique polyphénolique produite naturellement dans plusieurs plantes. On le trouve en forte concentration dans la peau des raisins (vin), les baies, le chocolat et les arachides. De nombreux bénéfices lui ont été accordés, dont ses effets anti-inflammatoires et ses capacités préventives contre le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et même la maladie d’Alzheimer. Une récente étude réalisée pendant un an sur 119 participants et conduite par le Professeur R. Scott Turner, du Georgetown University Medical Center, a permis de confirmer l'activité métabolique du resvératrol (à des doses croissantes allant jusqu’à deux grammes par jour) dans les cellules traitées.
Ces recherches montrent que le resvératrol facilite la dispersion de la protéine précurseur de l'amyloïde (APP) et favorise l'élimination des protéines neurotoxiques bêta-amyloïde (Aß), et parvient ainsi à ralentir le développement et la progression de la maladie d’Alzheimer. Enfin, le resvératrol réduit également les dommages aux cellules neuronales, grâce à l’action de protéines bénéfiques, les sirutines. Or, de manière très intéressante, on sait que ces mêmes protéines sont également activées par la restriction calorique et il a également été établi, par des études sur l’animal, que la maladie d’Alzheimer, comme de nombreuses pathologies liées à l’âge, peut être évitée ou retardée par la restriction calorique à long terme.
Mais pour mieux combattre la Maladie d’Alzheimer grâce à ces nouveaux traitements, encore faut-il parvenir à détecter le plus précocement possible cette pathologie dévastatrice : c’est justement cette perspective que promet l’équipe de recherche de Robert Naguele, de l’université américaine de Rowan (New Jersey), (Voir Rowan University).
Ces chercheurs ont d’abord identifié 50 marqueurs biologiques qui seraient présents dès le début de la maladie et qu’il faut donc rechercher. Les chercheurs ont ensuite soumis 236 patients à ce dépistage, dont 50 atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade très précoce (comme démontré par leurs faibles taux de protéine bêta-amyloïde 42 dans le liquide céphalorachidien). Le test de dépistage a permis d’identifier l’ensemble de ces 50 patients. L’équipe prévoit désormais de reproduire cette évaluation du test à plus grande échelle. A terme, ce test pourrait permettre de détecter de manière très fiable (98 % de précision) la maladie bien avant l’apparition des premiers symptômes. « Il est aujourd’hui admis que les modifications liées à la maladie d’Alzheimer débutent dans le cerveau au moins 10 ans avant les premiers symptômes », souligne le chercheur, qui ajoute « Pour les patients positifs à ce test, nous pourrions immédiatement proposer des stratégies thérapeutiques personnalisées qui seraient alors bien plus efficaces et retarderaient considérablement ou même préviendraient le déclenchement de cette maladie invalidante ».
Face à la complexité déroutante de cette maladie, les chercheurs ne se contentent pas d’explorer de nouvelles pistes thérapeutiques, ils proposent également de nouvelles approches théoriques de plus en plus solides. C’est ainsi que Rudy Tanzi et Robert Moir, deux chercheurs de la prestigieuse école de médecine de Harvard (Etats-Unis), font l’hypothèse que les plaques de protéines bêta-amyloïdes présentes dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et que l'on considérait comme responsables de la maladie, auraient en fait un rôle positif dans la lutte contre la maladie. Selon ces chercheurs, cette pathologie neurodégénérative serait déclenchée par une réponse immunitaire, ce qui expliquerait pourquoi les médicaments qui ciblent cette protéine n’ont pas d’effet sur la progression de la maladie (Voir Science Translational Medicine).
Selon cette théorie iconoclaste, la maladie d'Alzheimer pourrait être déclenchée par une réponse immunitaire « lorsque le cerveau a l'impression d'être l'objet d'attaques d'éléments pathogènes envahisseurs » soulignent les chercheurs. Cette hypothèse conforte également l’importance des facteurs liés au mode de vie - activité physique régulière, sommeil de qualité et alimentation saine - pour prévenir la maladie d'Alzheimer. En effet, selon Rudy Tanzi et Robert Moir, « Il est probable que si notre qualité de vie permet au cerveau de fonctionner correctement, celui-ci sera en mesure de combattre les infections sans réagir de façon excessive et inflammatoire ».
Cette nouvelle théorie très intéressante mérite d’autant plus d’être explorée et approfondie qu’elle vient, il y a quelques jours, d’être prolongée et étayée par une autre étude américaine qui montre qu’une prise en charge pluridisciplinaire précoce et personnalisée de la maladie d’Alzheimer peut conduire, pour certains patients, à une régression des symptômes (Voir Science Daily).
Ces recherches réalisées sous la direction de Dale Bredesen par des chercheurs de l’Institut Buck pour la recherche sur le vieillissement et l’Université de Californie de Los Angeles ont montré, sur dix patients atteints d’une forme débutante d’Alzheimer ou son stade précurseur MCI (Mild Cognitive Impairment), qu’il était possible d’obtenir une amélioration sensible des facultés cognitives, et cela uniquement par une prise en charge intensive variée et personnalisée, portant aussi bien sur l’alimentation, la supplémentation en certaines substances, que sur des exercices...
Ce résultat pour le moins surprenant a été obtenu en appliquant le nouveau protocole baptisé MEND (amélioration métabolique pour la neurodégénescence). Mis au point il y a deux ans par cette équipe et reposant sur une approche thérapeutique résolument multidisciplinaire qui intègre toutes les avancées fondamentales dans la connaissance des facteurs pouvant contribuer à augmenter les risques d’Alzheimer. Sachant par exemple que la réduction de l’'inflammation et de la résistance à l'insuline semble protéger notre cerveau de cette pathologie, ce protocole MEND comporte un volet visant à réduire ces deux facteurs par un régime alimentaire pauvres en glucides simples (glucose, saccharose) et facteurs d’inflammation (graisses animales..) ou en favorisant le jeûne.
D’autres études ayant établi le rôle nocif, pour notre cerveau, d’une production excessive de cortisol, hormone du stress, MEND essaye également de diminuer le niveau de stress, par du yoga et de la méditation. Un autre axe d’action concerne la pratique régulière d’une activité physique adaptée, pour renforcer la résistance du cerveau aux agressions et au déclin cognitif. Au total, ce protocole se compose donc comme un véritable "bouquet thérapeutique" qui comporte une vingtaine d’objectifs complémentaires aux effets potentiellement synergiques.
A l’issue de ce programme personnalisé de deux ans, l’étude constate une "amélioration cognitive subjective marquée" pour tous les patients ! Six d’entre eux ont vu également une amélioration nette aux tests de neuropsychologie. Enfin, des examens IRM ont montré, chez l'un d'entre eux, une récupération du volume de l'hippocampe, structure cérébrale essentielle à la mémorisation, qui se réduit avec la maladie.
Pour l’un des patients, souffrant d’un Alzheimer diagnostiqué en 2003, la récupération cognitive a été impressionnante : après six mois de protocole MEND, il a été à nouveau en mesure de reconnaître les visages au travail, de se rappeler son agenda et de travailler normalement…
Ces recherches montrent également que cette amélioration de l’état cognitif des patients est stoppée si ceux-ci arrêtent le protocole plus de deux semaines mais cette amélioration des facultés cognitives se manifeste à nouveau quand ces patients reprennent le protocole.
Commentant ces résultats, Dale Bredesen reste cependant prudent et souligne que de nombreux points restent à éclaircir, à commencer par l’influence réelle de la mutation sur le gène ApoE, dont étaient porteurs neuf des dix patients soumis à ce protocole et qui est impliquée dans les voies de régulation de l’inflammation et des lipides. Mais cette étude pose beaucoup d’autres questions, comme par exemple de savoir à partir de quel âge, et combien de temps, en l’absence de symptômes déclarés de maladie d’Alzheimer, faut-il appliquer ce protocole pour en retirer le bénéfice optimal ?
Il est remarquable de constater que toutes ces avancées très récentes, qu’elles soient de l’ordre de la recherche fondamentale ou du domaine clinique et thérapeutique, sont en train de provoquer un véritable basculement conceptuel dans la façon dont les médecins et scientifiques abordent et combattent cette pathologie protéiforme dans laquelle interagit une multitude de facteurs biologiques, environnementaux et psychologiques.
On sait en effet à présent que nos choix de vie (alimentation, sport), notre « appétit » intellectuel et la richesse de nos relations sociales et affectives, loin de jouer un rôle subsidiaire, occupent une place essentielle pour prévenir mais aussi pour mieux prendre en charge cette terrible maladie qui dépossède les sujets de leur identité. Le grand défi de ces prochaines années sera, en combinant la puissance des outils biotechnologiques et numériques, de proposer à l’ensemble de nos concitoyens une prévention précoce et personnalisée de cette pathologie, accompagnée d’une stratégie thérapeutique complètement individualisée. Celle-ci intégrera notamment la structure psychologique et l’évolution familiale et affective et pourra ainsi proposer à chacun une réorientation adaptée de son mode de vie qui sera intrinsèquement d’une grande efficacité préventive et thérapeutique.
Nous ne pouvons bien sûr que nous réjouir de ces progrès remarquables dans la compréhension et le traitement de la maladie d’Alzheimer mais il faut aller plus vite et plus loin : c’est pourquoi je souhaite que l’Europe, qui traverse actuellement une crise de confiance sans précédent depuis sa création, il y a près de 60 ans et cherche un nouveau souffle qui puisse susciter à nouveau l’adhésion voire l’enthousiasme des habitants de notre continent, prenne rapidement une initiative forte dans ce domaine ô combien concret et lance un ambitieux programme visant sur une génération à mettre un coup d’arrêt à la progression de cette terrible maladie.
René TRÉGOUËT
Sénateur honoraire
Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
TIC |
|
 |
Information et Communication
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
Le groupe suisse Roche a présenté un test d'automesure connecté par Bluetooth pour faciliter le traitement à domicile des patients sous AVK. Il s'agit du premier dispositif de mesure du taux de prothrombine (TP) et de l'INR au domicile utilisant cette technologie.
Baptisé CoaguChek INRange, cet appareil leur permet de se tester régulièrement par une piqûre du doigt et d'obtenir le résultat en soixante secondes. Le résultat est disponible en temps réel par les cliniciens qui peuvent adapter le traitement sans que le patient ait besoin de se déplacer dans un centre de suivi, comme c'est actuellement le cas.
L'automesure fréquente est nécessaire pour garantir aux patients un traitement adapté, et donc éviter AVC ou saignements, risque premier des traitements anticoagulants.
Selon le Laboratoire Roche, une surveillance mensuelle permet de 50 % à 60 % des patients de bénéficier d'un dosage AVK adapté. Ce pourcentage est de 77 % à 85 % si la surveillance est hebdomadaire et de 92 % si elle a lieu tous les trois jours.
Selon le laboratoire Roche, des données probantes suggèrent que les patients qui ont un lien fort avec leur professionnel de santé respectent mieux leur plan de traitement anticoagulant. Le système CoaguChek INRange aide à améliorer la relation entre les patients et leurs prestataires de soins. Les patients acquièrent une compréhension plus approfondie de leurs résultats relatifs au TP/INR grâce à des automesures fréquentes. Et les médecins se sentent plus à même d’optimiser efficacement les décisions thérapeutiques car ils ont accès presque en temps réel aux données des patients.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
Roche
|
 |
| ^ Haut |
 |
|
 |
|
 |
|
|
Avenir |
|
 |
Nanotechnologies et Robotique
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
Avec dix mille décès par an en France, le cancer de la prostate est le quatrième cancer le plus meurtrier et touche un homme sur six entre 60 et 79 ans. En parallèle de la prostatectomie généralement pratiquée, il existe à présent plusieurs alternatives thérapeutiques moins radicales, parmi lesquelles la curiethérapie, utilisée pour traiter des cancers précoces de la prostate.
Rappelons que cette technique de radiothérapie interne implique l’action de rayonnements ionisants provenant de grains d’iode radioactif placés temporairement ou à demeure dans la tumeur et irradiant les cellules cancéreuses pour les détruire.
A l’aide d’aiguilles et d’une grille de guidage, le radiothérapeute dépose, par voie périnéale et sous anesthésie générale, entre 60 et 100 grains de quelques millimètres chacun. Le dépôt, conventionnellement rectiligne, est contrôlé en cours d’intervention sous guidage d’une sonde d’échographie endorectale et proportionnelle à la taille de la glande.
La technique, qui préserve les tissus sains voisins (vessie, rectum, canal anal) et l’intégrité de la prostate, réduit l’apparition de phénomènes d’incontinence et de perte de la fonction sexuelle généralement observés avec les autres traitements, tout en conservant des taux de guérisons comparables.
Mais comme le souligne Rochdi Merzouki, « la procédure complète dure près de deux heures. La fiabilité et la précision des dépôts reposent sur la dextérité du radiothérapeute, exposé aux radioéléments pendant l’intervention. Les risques inflammatoires et les souffrances post-opératoires liés aux multiples insertions d’aiguilles ne sont pas négligeables pour le patient ».
C’est pour améliorer ces facteurs que ce chercheur travaille depuis 7 ans, en collaboration avec des médecins du Centre régional de lutte contre le cancer Oscar Lambret, sur la mise au point du premier robot de curiethérapie automatisée. Après un modèle de première génération, en 2012, un prototype de deuxième génération passe avec succès des tests sur tissus humains en 2015.
Aujourd’hui, cette équipe vient de présenter un prototype de troisième génération, tout juste finalisé. Le dispositif médical, peu encombrant, comprend un bras robot contrôlable en force et en position et disposant de sept axes de liberté, une unité opérationnelle porte-aiguille couplée à une sonde d’échographie 2D et une caméra, et un logiciel de supervision.
Une fois le dispositif auto-calibré, le radiothérapeute peut télécommander le bras robotisé pour réaliser, de façon synchronisée et automatisée, le chargement d’un grain depuis un magasin logé dans l’unité opérationnelle, sa propulsion dans l’aiguille unique et son dépôt dans la zone cible de la prostate. Grâce aux données fournies par un système de capteurs embarqués, le dépôt est analysé en temps réel et contrôlé par le radiothérapeute via le logiciel de supervision. Son erreur est ainsi limitée à 5mm.
Le nombre de points d’entrée de l’aiguille se trouve également réduit. « Grâce à la mobilité du robot, on passe d’une cinquantaine de points d’entrée à moins d’une dizaine ici, ce qui limite les risques d’inflammation post-opératoires ». « Avec ce dispositif, l’intervention dure finalement une quinzaine de minutes, ce qui limite grandement le temps d’exposition du radiothérapeute au radioéléments » conclut Rochdi Merzouki. Autre utilisation possible du dispositif : la pratique de biopsies.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
Senior Actu
|
 |
| ^ Haut |
 |
|
 |
|
 |
|
|
Matière |
|
 |
Matière et Energie
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
Un système utilisant des faisceaux laser s'est montré capable de détecter et d’identifier une espèce d’insectes volants porteurs de bactéries pathogènes, et de les détruire en plein vol. Baptisé Photonic Fence (barrière photonique), ce dispositif, destiné à contrôler les entrées d’insectes volants par l’ouverture d’une pièce ou d’une serre d’horticulture, est développé par l’Intellectual Ventures Laboratory, aux Etats-Unis.
Le système est constitué de trois modules. Le premier détecte le passage de l’insecte, le second l’identifie, et le troisième procède à l’éradication par une impulsion laser de faible intensité. Un logiciel pilote le tout en temps réel. La portée du système testé par les chercheurs est d’environ huit mètres.
Deux insectes nuisibles ont été ciblés par les chercheurs, à titre de démonstration. Le moustique Anopheles stephensi, vecteur de la malaria, et le psylle Diaphorina citri, agent de propagation de la maladie du dragon jaune (citrus greening), qui affecte les agrumes. Pour les détecter, des technologies de pointe sont nécessaires. Deux lasers dont les faisceaux se croisent, avec en face des photodiodes pour mesurer leurs émissions. Quand un insecte passe dans les faisceaux, l’intensité mesurée diminue, et la cible est ainsi détectée.
La scène est observée par une caméra à grande vitesse, qui filme à raison de 1000 images par seconde. Pour repérer les insectes visés, Photonic Fence ne se contente pas de l’analyse des images de la caméra : il identifie l’insecte en mesurant la fréquence de ses battements d’ailes.
Une fois la cible identifiée, il faut la détruire. Là encore, c’est un laser qui est utilisé. Mais contrairement aux armes laser "létales" que les militaires préparent, une très faible quantité d’énergie suffit pour mettre un moustique hors de combat : quelques millijoules. Ce qui est de bon augure pour une utilisation du système à proximité d’êtres humains.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
Phys
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Les États-Unis pourraient satisfaire la totalité de leurs besoins en électricité grâce à une source énergétique renouvelable disponible en quantité illimitée : le rayonnement du soleil. Pour atteindre cet objectif, il suffirait, selon la société Solar City, que les Etats-Unis recouvrent 0,6 % de leur territoire avec des panneaux solaires.
Pour en arriver à cette conclusion, la société d’Elon Musk s’est appuyée sur deux études : la première concerne la production électrique totale des États-Unis et la seconde est centrée sur l’emprise au sol des panneaux solaires.
Selon les chiffres de la première étude, publiée par le ministère de l’énergie des États-Unis, la production électrique américaine s’est élevée en 2015 à 4 000 TWh (dont un faible pourcentage est issu de l’énergie solaire). Et selon la seconde étude, publiée par le laboratoire sur les énergies renouvelables, une surface solaire au sol de 2,8 acres (soit 0,011 km²) de panneaux solaires permettrait de produire 1 GWh d’électricité en une année.
Après une simple multiplication, Solar City arrive à la conclusion que 6.901.824 acres (soit quelque 27.930 km²) recouverts de panneaux solaires permettraient de générer suffisamment d’électricité pour répondre à la demande nationale annuelle des États-Unis. Et ce, sans émettre une seule tonne de gaz à effet de serre.
Le coefficient d’emprise au sol utilisé par Solar City correspond à celui des installations solaires les plus performantes : celui issu des centrales photovoltaïques de plus de 20 MW équipées de panneaux à concentration à 2 axes. À titre de comparaison, il faudrait 4,4 acres (soit 0,017 km²) de panneaux solaires fixes en toiture pour produire 1 GWh en une année.
Reste la question du stockage de l’énergie. Car, par définition, l’énergie solaire est intermittente : les moments de production (tributaires du degré d’ensoleillement) ne correspondent en effet pas nécessairement aux moments de consommation. Il serait donc important de stocker une grande partie de l’énergie produite pour la restituer ultérieurement.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
LEG
|
 |
| ^ Haut |
 |
|
 |
|
 |
|
|
Espace |
|
 |
Espace et Cosmologie
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
Deux ingrédients essentiels à la vie sur la Terre, la glycine et le phosphore, ont été détectés sur la comète Tchouri (67P/Tchourioumov-Guérassimenko). Alors que plus de 140 différentes molécules organiques ont déjà été identifiées dans le milieu interstellaire, il s'agit d'un pas de plus vers la longue marche menant à l’apparition du vivant.
Ces éléments ont été mis en évidence dans le nuage de poussière et de gaz de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko, plus simplement nommée Tchouri. Cette découverte a été faite par ROSINA, le spectromètre de masse développé par les chercheurs bernois, qui y avait déjà décelé de l'oxygène et de l'argon. Depuis longtemps, la possibilité que les briques fondamentales de la vie aient été amenées sur Terre par les comètes est discutée. Mais jusqu'ici, seules des traces du plus simple des acides aminés, la glycine, avaient été décelées sur la comète Wild-2 par la NASA, sans pouvoir toutefois exclure une contamination terrestre des échantillons.
Or ROSINA a détecté de la glycine dans la chevelure de Tchouri en octobre 2014, selon ces travaux publiés dans la revue "Science Advances". "Il s'agit de la première preuve directe de la présence d'acides aminés dans l'atmosphère fine d'une comète", explique Kathrin Altwegg, chef du projet ROSINA à l'Université de Berne et co-auteure de l'étude, citée dans un communiqué de la haute école.
En plus de la glycine, seul acide aminé pouvant se former sans eau liquide, ROSINA a détecté les molécules organiques méthylamine et éthylamine, des substances primaires nécessaires à la formation d'acides aminés dans la glace.
Autre élément trouvé pour la première fois sur une comète, du phosphore, "colonne vertébrale" de l'ADN et de l'ARN. Ces découvertes "renforcent la thèse selon laquelle les comètes ont participé à l'apparition de la vie sur Terre", commente Matt Taylor, responsable du projet Rosetta à l'Agence spatiale européenne (ESA).
c’est la première fois que l’on y détecte de la glycine, un acide aminé, et du phosphore, un élément clé de l’ADN et des membranes des cellules. Ces travaux, menés avec Rosina, le spectromètre de la sonde européenne Rosetta en orbite autour de ce noyau cométaire, sont publiés dans la revue américaine ScienceAdvances.
« Ces ingrédients fondamentaux de la vie s’ajoutent à la multitude de molécules organiques déjà identifiées par Rosina sur la comète. Ils confirment notre hypothèse que les comètes ont le potentiel d’apporter les molécules essentielles de la chimie prébiotique », souligne Matt Taylor, responsable scientifique de la mission Rosetta de l’Agence Spatiale Européenne (ESA).
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
ESA
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
La vie existe-t-elle sur Europe, cette lune gelée de Jupiter ? L'hypothèse est possible et les indices s'accumulent pour faire d'Europe l'une des candidates les plus sérieuses pour la recherche de vie dans le système solaire.
Une récente étude réalisée par des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa concerne le ratio oxygène/hydrogène dans l’océan d’eau salée qu’abrite Europe sous sa croûte glacée. Selon ces travaux, il y aurait dans les profondeurs d’Europe environ dix fois plus d’oxygène que d’hydrogène. Un montant à peu près similaire à ce qui est généré dans les océans terrestres mais dans ces deux mondes, l’hydrogène est produit par des mécanismes différents.
Si les scientifiques s’intéressent autant à ces deux gaz, c’est parce que « le cycle de l'oxygène et de l'hydrogène constitue un moteur important de la chimie des océans d’Europe et donc de la vie qui pourrait y exister, exactement comme sur Terre », affirme Steve Vance du JPL et principal auteur de l'étude. « Pas facile cependant d’étudier un océan étranger en utilisant des méthodes développées pour comprendre le mouvement de l'énergie et des nutriments dans les systèmes propres de la Terre ». Sur Terre, l’hydrogène est produit en bonne partie par les volcans sous-marins.
Mais sur Europe, il n’y a pas de volcanisme. La source de l’hydrogène se situe ailleurs : dans les fissures qui cisaillent le plancher océanique et qui peuvent mesurer jusqu’à 15 kilomètres de profondeur. Au fur et à mesure qu’Europe refroidit, de nouvelles anfractuosités s’ouvrent et de l’eau s’y engouffre. Au contact des roches, une réaction appelée serpentinisation se produit et les minéraux hydratés dégagent de l’hydrogène et du méthane.
« Grâce à ce mécanisme, une énorme quantité d’hydrogène est produite et elle équilibre la production d’oxygène dans un rapport comparable à celui des océans terrestres », précise Steve Vance. Il faut remonter à la surface pour trouver la source de cet oxygène qui, présent en excès, annihilerait tout espoir de vie. Ce sont les rayonnements de Jupiter sur la glace de surface qui scindent les molécules d’eau et forment ainsi les atomes d’oxygène qui diffusent ensuite dans l’eau. « L’oxygène de la glace est comme la borne positive d'une batterie et les produits chimiques du plancher océanique sont comme la borne négative.
Ce qui complète le circuit, que ce soit ou non des processus biologiques, fait partie de ce qui motive notre exploration d’Europe », complète Kevin Hand, du JPL. Ces résultats indiquent que l’océan sub-glaciaire d’Europe semble propice au développement de la vie telle qu’on la connaît sur Terre. D’autres évaluations sont en cours pour estimer la quantité de carbone, d'azote, de phosphore et de soufre. Mais en fin de compte, seule une mission avec un atterrissage sur Europe permettra de savoir si effectivement de la vie a pu s’y développer.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
GRL
|
 |
| ^ Haut |
 |
|
 |
|
 |
|
|
Terre |
|
 |
Sciences de la Terre, Environnement et Climat
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
Le rapport que vient de publier le Département Américain de l'Energie donne une idée de l’effort que va devoir accomplir la communauté internationale. L’organisme américain estime que les émissions de gaz à effet de serre vont encore augmenter d’un tiers d’ici 2040.
Cette évaluation ne tient que très partiellement compte de l’engagement des Etats, reconnait l’EIA. L’organisme a eu du mal à évaluer l’apport réel des contributions nationales à l’effort commun de réduction. Ces engagements varient en effet énormément entre réduction réelle des émissions de CO2, volonté d’atteindre un pic d’émissions à plus ou moins long terme, prise en compte des puits de carbone comme les forêts, etc. Mais malgré ces restrictions, l’EIA parie pour une croissance continue des émissions qui rend illusoire l’objectif de limiter les températures à 1,5°C pour arriver plutôt à 3°C.
Dans le détail, les Américains estiment que la part de la consommation des énergies fossiles va reculer de 82 % en 2012 à 78 % en 2040 devant la poussée des énergies renouvelables. Les changements d’utilisation des énergies fossiles devraient également permettre de réduire l’intensité carbone (c’est-à-dire les émissions de CO2 par bien produit). La part du charbon -le plus polluant- va descendre de 28 % en 2012 à 22 % en 2040 et celle du fuel de 33 à 30 % tandis que la part du gaz montera de 23 à 26 %.
La quantité d’énergie pour fabriquer un bien (ou efficacité énergétique), devrait baisser de 0,4 % par an. Des progrès qui sont insuffisants vis-à-vis de la hausse de la consommation de biens et des besoins des pays en voie de développement. Car le message principal de l’administration américaine, c’est que la part des émissions des 34 pays les plus riches membres du club de l’OCDE diminue face à la croissance des pays émergents.
Toute l’habileté de la COP21 a été de rechercher un partage équitable de l’action entre pays riches pollueurs historiques et pays en voie de développement en forte croissance. Le rapport du GIEC de 2014 a par ailleurs fait remarquer qu’une grande partie de l’énergie et des matières premières consommées par les pays émergents servait à la fabrication de biens exportés dans les pays riches.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
EIA
|
 |
| ^ Haut |
 |
|
 |
|
 |
|
|
Vivant |
|
 |
Santé, Médecine et Sciences du Vivant
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
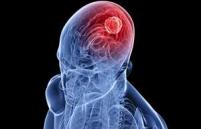 |
|
La FDA, l'Agence Fédérale américaine du Médicament, a autorisé un dispositif destiné à combattre la dépendance aux drogues opiacées. Celui-ci, consistant en 4 bâtonnets de 2,5 cm de long implantables sous la peau de la partie supérieure du bras, est conçu pour délivrer, d’une manière constante, une faible dose de buprénorphine pendant six mois. Ce médicament agit en se fixant aux récepteurs opioïdes cérébraux. Il permet, sur une période prolongée, de réduire le besoin en drogues (héroïne et autres opiacés) chez les patients toxicomanes. Cette alternative thérapeutique pourrait améliorer l’observance des patients, qui ne seraient plus astreints à suivre un traitement quotidien.
Cette nouvelle modalité thérapeutique ne concerne cependant que le traitement de maintenance de la dépendance aux opiacés. Elle est en effet destinée à être utilisée pour les seuls patients déjà stabilisés grâce à ce même traitement substitutif (à dose faible ou modérée), pris sous forme d’un comprimé ou d’un film sublingual qui se dissout dans la bouche. Elle devra s’effectuer sous la prise en charge d’un médecin expérimenté et s’accompagner d’une intervention psychothérapeutique et sociale, précise l’agence sanitaire américaine.
En effet, la pose et le retrait de ce dispositif nécessitent un geste chirurgical. De plus, ce traitement de substitution aux opiacés doit s’intégrer dans un processus global d’accompagnement, de suivi médico-psychologique, socio-éducatif et de réinsertion de la personne dépendante afin qu’elle puisse espérer retrouver une meilleure qualité de vie. La FDA conseille que les patients recevant le nouvel implant soient fréquemment suivis après la pose et au moins une fois par mois par la suite dans le cadre de la prise en charge médico-psychologique.
Une récente étude randomisée montre que 63 % des patients traités par implant n’avaient pas consommé d’opioïdes au cours des 6 mois de traitement contre 64 % par les patients qui avaient utilisé le comprimé sublingual. Au vu de ces nouveaux résultats, l'agence américaine a considéré que l’efficacité de l’implant de buprénorphine n’était pas inférieure au comprimé.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
WSJ
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Une étude française a montré des liens entre l'inflammation chronique, l'altération du quotient intellectuel et des capacités de pensée abstraite. Selon ces travaux, l'inflammation observée chez des patients schizophrènes est associée à un niveau intellectuel général plus bas et à des déficits cognitifs plus prononcés.
L'étude a été menée entre 2011 et 2015 chez 369 patients suivis par dix centres experts du réseau de coopération scientifique en santé mentale. Pour mesurer l'inflammation, les chercheurs ont fait appel à un marqueur détectable par prise de sang, la protéine C réactive (CRP).
« Aucune imagerie ou radiomarqueur ne permet de visualiser l'inflammation dans le cerveau. C'est donc l'inflammation périphérique qui est recherchée », explique le Docteur Guillaume Fond, psychiatre à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, coordinateur du réseau des centres experts schizophrénie et coauteur de l'étude.
Chez près de 3 patients sur 10, le taux de CRP indiquait la présence d'une inflammation chronique. Le quotient intellectuel de ces malades était inférieur à celui des patients sans inflammation et le niveau de pensée abstraite était altéré. « Nous avons également constaté une altération du QI verbal, alors qu'il est considéré comme un marqueur du niveau d'éducation et de l'environnement social », ajoute Guillaume Fond.
L'inflammation est un processus naturel qui permet à l'organisme de se défendre contre des agressions, comme les infections ou les plaies. Mais dans certains cas, l'extinction de l'inflammation une fois l'agression terminée fait défaut, ce qui conduit à une inflammation chronique. Un régime alimentaire riche en graisses et en sucres rapides, la consommation de tabac, d'alcool, la sédentarité, un déficit en vitamine D… sont autant de causes connues de l'inflammation.
Au-delà de la confirmation de l'existence d'une corrélation entre inflammation et déclin cognitif dans la schizophrénie, cette étude pourrait modifier la prise en charge des malades schizophrènes. « Pour le moment, les recommandations se focalisaient essentiellement sur le bilan lipidique et endocrinologique, car ces patients sont connus pour être à plus haut risque cardiovasculaire. Un dosage systématique de la CRP semble recommandé, et lorsqu'elle est anormale, un bilan cognitif poussé devrait être prescrit », affirme Guillaume Fond.
« Les altérations cognitives représentent la plus grande source de handicap pour les personnes souffrant de schizophrénie », précise Ewa Bulzacka, neuropsychologue et coauteur de l'étude. Le traitement actuel du déficit cognitif est la remédiation cognitive, une thérapie spécifique visant à réentraîner le cerveau à se concentrer et à se souvenir.
La piste inflammatoire ouvre la porte à de nouveaux traitements : des anti-inflammatoires, les oméga 3, la N-acétylcystéine (un acide aminé antioxydant), la vitamine D, les modifications du régime alimentaire et l'activité physique pourraient ainsi améliorer la cognition des schizophrènes. « Nous avons lancé une étude observationnelle pour voir si, en améliorant l'inflammation grâce aux modifications alimentaires et à l'activité physique, par exemple, nous obtenons des résultats sur les troubles cognitifs », explique Guillaume Fond.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
Schizophrenia
|
 |
 |
 |
|
|
 |
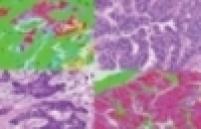 |
|
Le professeur Éric Asselin, directeur de l'UQTR, a découvert un nouveau mécanisme cellulaire fondamental qui, selon lui, pourrait être utilisé comme arme anti-cancer. Selon cette découverte, c'est en conjuguant certains traitements que les résultats semblent les plus prometteurs.
Pour comprendre cette découverte et son importance, il faut se rappeler que dans le cancer, les réactions chimiques normales qui permettent l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules, sont déréglées. La cellule reçoit au contraire un signal de se multiplier. Se forme alors une tumeur cancéreuse.
Normalement, c'est la PAR-4 (prostate apoptosis response-4) qui intervient et induit la mort des cellules. Mais dans beaucoup de cancers, ce mécanisme devient défectueux et la PAR-4 n'agit plus. Les chercheurs de l'UQTR ont introduit la PAR-4 dans les cellules cancéreuses à titre de protéine thérapeutique, certains que sa simple présence allait donner aux cellules le signal de mourir, ce qui aurait mis fin à leur prolifération anarchique, donc à la tumeur. À leur grande surprise, la PAR-4 disparaissait au lieu de remplir sa mission. « On savait que la protéine était pourtant introduite dans la cellule. Mais elle n'était pas là », a constaté le professeur Asselin.
L'équipe de l'UQTR a fini par comprendre que la PAR-4 avait été dégradée par le protéasome, un complexe enzymatique que le professeur Asselin compare à une véritable usine de recyclage microscopique qui transforme les protéines obsolètes en plus petites composantes en vue d'être réutilisées. Il fallait donc trouver la cause de ce phénomène et trouver le moyen d'empêcher que la PAR-4 disparaisse afin qu'elle puisse jouer son rôle de suppression des tumeurs.
L'équipe du professeur Asselin a compris que le protéasome est contrôlé par une voie de signalisation appelée AKT, c'est-à-dire une route par laquelle des messages chimiques parviennent jusqu'au noyau de la cellule. En bloquant cette voie de signalisation AKT, les chercheurss ont montré qu'il était possible de réactiver la PAR-4 et de provoquer à nouveau la mort des cellules malignes. Les travaux de l'UQTR sont extrêmement prometteurs et l'équipe prévoit faire des essais sur des souris de laboratoire dès cet été ou cet automne.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
La Presse
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
L’otite moyenne à répétition, pathologie fréquente chez l'enfant, peut être à l’origine de séquelles telles qu’une baisse de l’audition, un retard d’acquisition du langage ou, plus rarement, de complications plus graves.
Une équipe internationale fait le point sur les récentes avancées dans la connaissance de la pathogénie des otites moyennes et sur l’impact que pourrait avoir la vaccination anti-pneumococcique sur la prévention des otites compliquées. Certains travaux ont en effet fait le lien entre la généralisation de la vaccination contre certains sérotypes de pneumocoques et la réduction de l’incidence des otites chroniques compliquées.
Selon ces recherches, quand des récidives se produisent, S.pneumoniae fait place à d’autres bactéries pathogènes ou d’autres sérotypes de pneumocoques, moins invasifs, assurant le passage à la chronicité. La présence d’ H.influenzae non typable lors des premiers épisodes pourrait quant à elle faciliter les infections par M. catarrhalis et autres pathogènes.
Selon les auteurs de l’étude, l’hypothèse la plus crédible est que les premiers épisodes infectieux sont à l’origine de dégâts au niveau de la muqueuse de l’oreille moyenne et de la trompe d’Eustache, qui créent une sorte de prédisposition à la colonisation par d’autres espèces moins invasives. Il s’ensuit une cascade d’épisodes infectieux et la formation d’un biofilm qui pourrait être la clé de la pathogénie de l’otite chronique, en favorisant une « collaboration inter-espèces ».
En réduisant le risque du premier épisode d’otite aiguë, le vaccin anti-pneumococcique permettrait aussi de réduire la fréquence des complications et particulièrement des otites compliquées causées par des sérotypes non inclus dans le vaccin et les autres pathogènes dont H.influenzae non typable. Les travaux indiquent que cette efficacité ne semble significative que si l’enfant est vacciné avant le premier épisode d’otite moyenne et donc avant que se produisent les premiers dégâts sur les muqueuses.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
NCBI
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Stéphane Rocchi, directeur du Centre méditerranéen de médecine moléculaire (Inserm), en collaboration avec le Docteur Benhida de l’Institut de Chimie de Nice, a identifié des propriétés anticancéreuses intéressantes chez une famille de molécules, les Thiazole Benzensulfonamides (TZB), d'abord utilisées pour traiter le diabète de type 2 car elles augmentaient la sensibilité des cellules à l’insuline.
Après de nombreux essais, la structure initiale a été profondément changée pour obtenir une formulation principale, appelée HA15. Cette dernière a la propriété de réduire la viabilité des mélanocytes sans être toxique pour les cellules normales : HA15 induit un stress du réticulum endoplasmique (un organite de la cellule), induisant la mort des cellules de mélanome par apoptose (processus par lequel des cellules déclenchent leur auto-destruction en réponse à un signal) et autophagie (mécanisme cellulaire qui consiste en la dégradation partielle du cytoplasme - l'intérieur de la cellule - en utilisant ses propres lysosomes : la cellule "se dévore" donc elle-même).
Cette molécule s'est avérée efficace chez la souris pour diminuer le volume de tumeurs, sans toxicité apparente. "Chez l’homme, nous avons montré que les molécules étaient actives sur des cellules de mélanomes prélevées sur des biopsies de patients sensibles ou résistantes aux thérapies ciblées", explique le chercheur.
Enfin, HA15 est aussi efficace sur des lignées cellulaires provenant d’autres tumeurs comme le cancer du sein, du côlon, de la prostate, du pancréas ou bien encore des gliomes ou des leucémies myéloïdes chroniques. "Le but ultime de ce projet est d’utiliser ces nouvelles molécules dans le traitement du mélanome et plus généralement dans d’autres types de cancers", conclut Stéphane Rocchi qui souhaite démarrer prochainement un essai clinique de phase 1.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
Cancer Cell
|
 |
 |
 |
|
|
 |
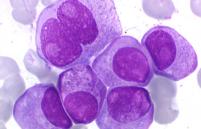 |
|
Le traitement du myélome multiple (5000 nouveaux cas en France par an) a évolué depuis 15 ans avec notamment l’introduction des anticorps monoclonaux, puis des inhibiteurs du protéasome et des trithérapies (comprenant en outre un immunomodulateur et de la dexaméthasone). A présent, une nouvelle étape est engagée avec l'expérimentation de molécules efficaces aux effets secondaires acceptables afin de permettre des thérapies prolongées.
Une étude sur 23 mois, multicentrique (147 sites et 26 pays) a suivi 722 patients souffrant d'une rechute et/ou d'un myélome réfractaire. Dans cet essai clinique de phase 3, mené en double aveugle, un groupe de malades a reçu, chaque semaine par voie orale, un nouvel inhibiteur du protéasome, l’ixazomib, associé au lénalidomide et à la dexaméthasone tandis que le groupe témoin a, lui, reçu un placebo conjointement à l’association lénalidomide-dexaméthasone.
Les résultats sont encourageants puisque la survie sans progression de la maladie (critère principal de l’étude), après un suivi médian de près de 15 mois, était significativement plus longue dans le groupe ixazomib par rapport à celle du groupe placebo (20,6 mois versus 14,7 mois), soit une différence de 35 % en faveur de l’ixazomib.
Et ce quel que soit le sous-groupe de patients, même chez ceux ayant un pronostic péjoratif comme les sujets âgés, en stade avancé de la maladie (stade III de l'International Staging System), les patients ayant eu plusieurs thérapies au préalable et ceux ayant des anomalies cytogénétiques à haut risque (19 % des 76% de malades chez lesquels cette recherche a été effectuée). Parmi ces derniers, 10 % étaient ainsi porteurs d'une del(17p) : dans ce sous-groupe, la survie sans progression s'est révélée bien plus longue avec l'ixazomib.
Les auteurs concluent que l'ajout de cet inhibiteur du protéasome, en l’occurrence l’ixazomib, au lénalidomide et à la dexaméthasone conduit à une augmentation significative de la survie sans progression de la maladie, avec des effets secondaires limités, offrant ainsi de nouvelles opportunités thérapeutiques.
Pour le Professeur Michel Attal, directeur général de l'Institut universitaire du cancer Toulouse Oncopole et spécialiste du myélome, "ces remarquables avancées nous laissent penser que nous parviendrons à guérir le myélome".
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
Cancer Network
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
La voix maternelle vient de révéler des vertus insoupçonnées. En 2015, un neurologue américain montrait qu'elle permet de booster le développement cérébral chez les bébés prématurés en couveuse. Précédemment, des études ont mis en évidence que les enfants préfèrent écouter la voix de leur mère à celle d'autres femmes. Pour quelle raison ? Des zones cérébrales spécifiques sont-elles activées ? C'est ce qu'ont voulu déterminer les chercheurs de l'Université de Stanford (États-Unis). Ce sont les premiers à avoir analysé les scans de cerveaux d'enfants écoutant les voix de leur mère.
Les chercheurs ont analysé par IRM le cerveau de 24 enfants âgés de 7 à 12 ans, au quotient intellectuel supérieur à 80, ne présentant aucun trouble du développement et élevés par leur mère biologique. Ils ont demandé à leurs parents de répondre à un questionnaire pour évaluer le niveau de sociabilité de leur enfant.
Pendant l'IRM, les jeunes volontaires ont écouté des bandes sonores enregistrées par leur propre mère. Les mots prononcés n'avaient aucun sens. "Entre 7 et 12 ans, la plupart des enfants ont de bonnes compétences linguistiques, nous ne voulions donc pas utiliser des mots qui avaient un sens parce que cela aurait activé des circuits totalement différents dans le cerveau", précise Vinod Menon, principal auteur de l'étude. Les enfants ont aussi écouté le même enregistrement sonore mais provenant cette fois de mères d'enfants non inclus dans l'étude et qui n'avaient jamais rencontré aucun des jeunes volontaires.
Selon les conclusions des chercheurs, 97 % des enfants ont été capables de reconnaître la voix de leur mère en moins d’1 seconde ! Mais cela n'est pas étonnant. En revanche, les chercheurs ont été surpris de constater qu'au-delà des zones cérébrales dédiées à l'audition, d'autres étaient bien plus stimulées par la voix maternelle que par celle des autres femmes : ces régions sont celles impliquées dans les émotions (l'amygdale), dans le circuit de la récompense (voie mésolimbique et cortex préfrontal médial), dans la conscience de soi, dans la perception et la reconnaissance faciale.
"Beaucoup des processus sociaux, linguistiques et émotionnels que nous adoptons viennent de l'écoute de la voix de notre propre mère", résume Daniel Abrams, co-auteur de l'étude. Avec ses collègues, ce dernier a également constaté que les enfants qui présentaient les connexions cérébrales les plus fortes entre ces différentes régions (après stimulation par la voix maternelle) étaient ceux présentant la plus forte aisance sociale et les plus importantes capacités de communication.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
PNAS
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Une étude américaine vient de mettre en évidence 43 gènes de prédisposition communs pour l'autisme et le cancer. Des chercheurs californiens ont découvert, pour la première fois, que deux pathologies pourtant très différentes, l’autisme et le cancer, partageaient des facteurs de prédisposition génétique. Selon le Professeur Jacqueline Crawley, l’auteure principale de l’étude : "Des mécanismes biologiques potentiellement similaires suggèrent qu'il pourrait être possible de réutiliser l’arsenal thérapeutique contre le cancer pour traiter les troubles du développement neurologique."
Pour expliquer les mécanismes en jeu, elle avance ces hypothèses : "La différence majeure entre ces deux maladies serait une simple question de 'timing'. En effet, autant l'autisme que le cancer surviennent lorsque l’organisme commet des erreurs de maintenance du génome, lors de la réparation de l'ADN ou de la réplication.
Mais c’est l'âge auquel ces erreurs se produisent qui détermine quels troubles apparaissent". Le Professeur Wolf-Dietrich Heyer, co-auteur de l’étude ajoute : "Des erreurs se produisant à des périodes critiques du développement cérébral d’un fœtus, par exemple, entraîneraient plutôt des troubles neurologiques, alors que des erreurs se produisant à l’âge adulte dans les cellules y engendreraient plutôt des tumeurs."
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash
Science Daily
|
 |
| ^ Haut |
 |
|
|
|
|
| VOTRE INSCRIPTION |
 |
Vous recevez cette lettre car vous êtes inscrits à la newsletter RTFLash. Les articles que vous recevez correspondent aux centres d'intérêts spécifiés dans votre compte.
Désinscription Cliquez sur ce lien pour vous désinscrire.
Mon compte pour créer ou accéder à votre compte et modifier vos centres d'intérêts.
|
|
|
|
|
|